Principes du paillage
Le paillage ; cette pratique qui nous vient des jardiniers-maraichers parisiens du 19ème siècle. Observateurs attentifs, excellents techniciens et… producteurs de légumes frais pour le tout Paris, ils l’avaient bien remarqué : déposer en surface du sol un fumier « à moitié consommé » apporte de nombreux bénéfices aux légumes ainsi chouchoutés.
Quatre essentiels :
- moins d’arrosages,
- peu de désherbage,
- un sol de bonne structure,
- une fertilité accrue.
Le sol, ainsi recouvert (à peine un centimètre selon ces experts), limite l’évaporation de l’eau et la germination des dites « mauvaises herbes » annuelles.

« Sans paillis, nous serions obligés de tripler les arrosements, et encore les légumes ne viendraient pas aussi bien. »
1845 – Moreau et Daverne
Concernant l’amélioration de la qualité du sol et de sa fertilité, nos anciens n’en connaissaient pas la cause. On sait aujourd’hui que les bactéries se nourrissent des matières organiques fraîches, puis libèrent rapidement des éléments nutritifs assimilés par les plantes. Elles produisent en même temps une sorte de colle qui agrège les fines particules de sol entre elles : la voilà notre terre grumeleuse, aérée et légère, ce « couscous » facilitant la pénétration des racines, la circulation de l’eau et de l’air.
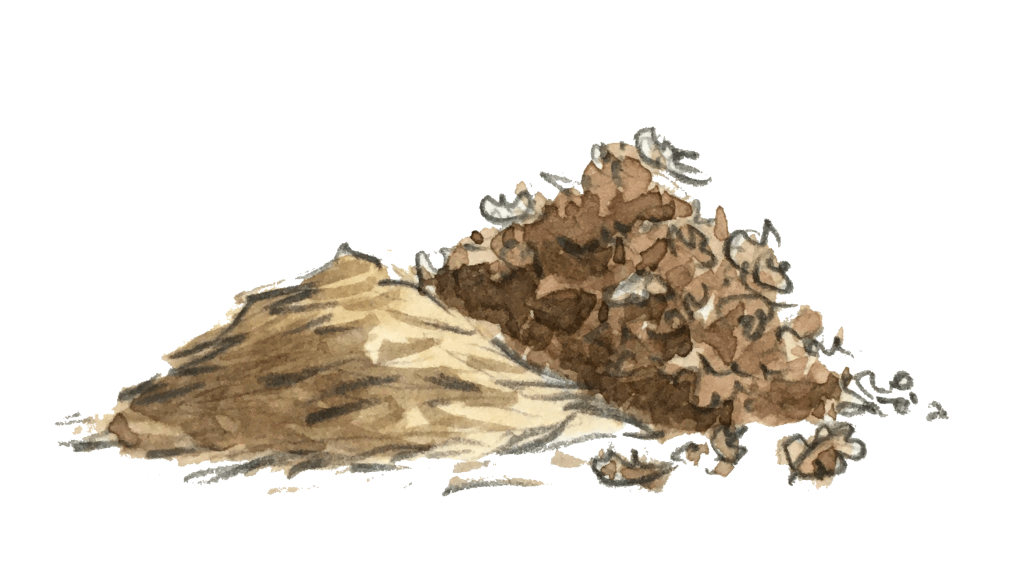
Les pionniers du paillage avaient sous la main une manne : un fumier de cheval abondant qu’ils rapportaient de la capitale au retour des livraisons de légumes. Ils retiraient ce fumier (composté en partie) des couches chaudes à melons ou des vieilles meules à champignons. Le paillis était de composition idéale. Un fumier de cheval de cet âge, humide et ayant chauffé quelques semaines : voilà un mets de choix pour les êtres vivants du sol, digeste, équilibré dans sa composition et rapidement dégradé.
Les pratiques ont évolué bien sûr, et si l’on paille à tout va dans nos jardins modernes, il est bon de garder la leçon de nos ancêtres jardiniers. Le paillage a ses petits secrets et coups de main à trouver : le bon paillis, au bon moment, sur la bonne culture…
Pailler oui, mais comment ?
Feuilles mortes à l’automne, herbes sèches, vieille paille récupérée chez le paysan voisin, tontes de gazon… Reste à savoir comment les utiliser. Voyons quelques conseils pour bien débuter en paillage !



- Un sol chaud. Le paillage protège le sol des rayonnements solaires, il empêche donc celui-ci de se réchauffer au printemps. Or tout jardinier le sait : les plantes ne poussent bien qu’à partir d’une certaine température du sol, variable selon les espèces. Le paillage devra être appliqué à partir des beaux jours, en Auvergne pas avant le mois de juin, afin de ne pas nuire à la bonne croissance des plantes.
- Un sol humide. Le paillage permet de retenir l’eau dans le sol en évitant sa perte par évaporation. Mais il limite aussi quelque peu son arrivée par les pluies qu’il absorbe, en particulier si elles sont faibles. Alors paillons, mais sur un sol déjà bien pourvu en eau !
- Un désherbage méticuleux. Le paillage doit faire gagner du temps dans l’entretien de la culture. Or, s’il stoppe la pousse des herbes indésirables annuelles en entravant physiquement leur croissance. Il ne peut malheureusement rien contre les vigoureuses vivaces que sont chardons, chiendents, liserons… Ces fidèles se contrefichent de l’épaisseur de matière à traverser ! Que les jardiniers se rassurent quand même : les quelques oubliées de la binette s’arracheront plus facilement à l’avenir dans un sol protégé, humide et souple.
- Plus le paillis est sec, coriace, grossier, plus il sera destiné aux plantes installées durablement. Pour exemple, le broyat de bois sera réservé aux fraises, framboises, euphorbes ou rosiers. Sa lente décomposition ne gênera pas le jardinier qui renouvellera les apports année après année. Laissons le fin gazon (vite digéré par le sol) aux laitues véloces !
- Pas de paillage hivernal en sols lourds. Puisqu’ils ont tendance au tassement, on leur préférera les engrais verts aux racines fouisseuses, aératrices, travailleuses…

Découvrir nos formations
-
Créer et animer un jardin pédagogique
S’outiller à la conduite d’un jardin pédagogique de sa conception à son accompagnement
-
Réaliser son terreau sans tourbe
Pour ses plantations et productions de plants.
-
Jardiner au naturel
Maîtriser les techniques et savoir les transmettre.
-
L’arbre fruitier : choisir, implanter et tailler
Choisir, implanter et tailler : s’outiller pour la bonne conduite, du choix à l’entretien.

