La forêt produit des plantes sans aucun besoin d’apport d’éléments fertilisants exogènes, c’est-à-dire sans apports d’éléments qui proviennent de l’extérieur de son environnement. Ça marche et ça pousse ! Notamment parce que ces plantes vont être les initiatrices de leur propre fertilité, grâce à une communauté d’êtres vivants et de processus biochimiques.
La matière organique morte, après transformation, va libérer des éléments nutritifs. On pense bien sûr aux feuilles, tiges, branches, fruits… c’est la partie aérienne des plantes qui tombe au sol pour former la litière et se décomposer lentement. Mais, il y a d’autres sources de production : les racines mortes et les exsudats racinaires (phénomène de rhizodéposition).
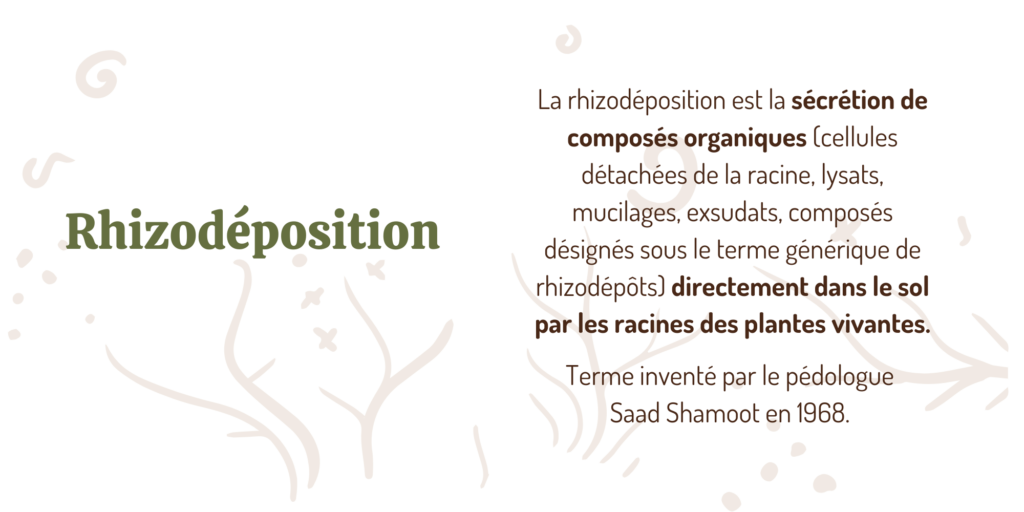

Au jardin, c’est la même histoire ! Pourtant, bien souvent le jardinier ou la jardinière exporte une quantité importante et régulière de ces matières organiques (récolte, arrachage de déchets verts)… et le sol va en manquer peu à peu. Il convient donc de réaliser ce que l’on appelle en agronomie des « flux d’apports au sol », c’est-à-dire restituer des résidus de cultures, des effluents d’élevage et des composts.
Or, il y a un avantage à ce que ces apports soient réalisés par des matières organiques brutes (entendez par là : non-compostées). Le compost, s’il est utile à bien des égards, présente des limites : durant son processus de fabrication, des éléments minéraux vont être perdus. Autant apporter directement la matière organique morte et fraîche au sol. Comme en forêt.
Pour le carbone, c’est plus de 2/3 des éléments minéraux qui partent dans l’atmosphère sous forme de CO2 lorsque le compost est obtenu avec montée de température (B. Noel, Rencontres Internationales de l’agriculture du Vivant 2019).
L’apport de matière organique se fait aussi en augmentant au maximum la production végétale sur la surface cultivée. Produire beaucoup en biomasse (aérienne et racinaire … le rendement du carbone du sol est 2.5 fois plus élevé pour le carbone rhizodéposé que pour les résidus des parties aériennes) est un gage de fertilité … à condition de restituer le maximum de cette biomasse au sol. C’est le principe des couverts végétaux (ou engrais verts).
Apporter de l’extérieur du système, ou restituer des matières organiques non transformées, est la plus efficace des méthodes pour redonner vie et fertilité au sol du jardin.
Les bénéfices de la gestion des déchets verts … pour les sols

Enrichissement en éléments minéraux qui pourront être disponibles pour les plantes cultivées.

Amélioration de
la structure du sol.
La structure, c’est l’agencement des particules élémentaires dans le sol. Elle dépend de la texture (composition du sol en fonction des différentes tailles de particules ; argiles, limons, sables) mais aussi de l’activité des micro-organismes. En nourrissant ces micro-organismes (par la matière organique), le jardinier ou la jardinière peut améliorer la terre et aller progressivement vers cette structure grumeleuse idéale, pour favoriser aération et circulation de l’eau dans le sol.
Comment ça marche ?
Les vers de terre anéciques (tels que notre populaire lombric commun), creusent des galeries verticales dans le sol pour venir en surface chercher la matière organique morte, dont ils se nourrissent (et grâce au soutien des bactéries et champignons qui commencent le travail de dégradation). Ces galeries sont autant de cheminées d’aération favorables à la pénétration de l’oxygène dans le sol, à l’évacuation du CO2 et bien sûr, facilitent grandement la pénétration de l’eau… et son évacuation lors des excès. Les racines des plantes en profitent au passage pour suivre le chemin de ces galeries et trouver par là une facilité de pénétration dans les profondeurs du sol… et des nutriments « déposés » par les vers dans ces galeries.
On parle ici de macroporosité du sol. Si nous voulons aider les vers à l’entretenir, il faut leur donner à manger ! Ceux-ci sont friands de nos déchets verts jeunes et tendres comme l’herbe. Le compost mûr n’intéresse pas ces lombrics, l’incorporation de cette matière fine étant trop difficile : il n’y a théoriquement plus rien à “manger” pour les vers.
La microporosité quant à elle est le résultat du travail des bactéries et champignons. Ces êtres vivants, lors du processus de dégradation des matières organiques, produisent une colle organique qui agrège les particules minérales pour former des micro-agrégats qui, à leur tour, vont former de plus grands agglomérats. Ainsi, le sol prend cette structure de couscous appelée « structure grumeleuse » par les agronomes. Elle apporte de l’air et permet également d’améliorer les propriétés et le fonctionnement hydrique des sols.
En effet, l’essentiel de l’eau du sol est stockée dans les petits canaux de ces agrégats. Ces canaux ne sont créés que par les êtres vivants. Les outils de travail du sol ne font que participer à leur destruction. Cette eau du sol se présente sous forme de films d’eau collés aux agrégats. Pour avoir une grande réserve en eau, il faut donc tout faire pour augmenter la microporosité du sol.
Là encore… vive l’apport des matières organiques au sol, principale nourriture des bactéries et champignons ! Toutefois, ce sont bien les plantes vivantes cultivées qui sont les plus efficaces pour produire du carbone : elles fonctionnent comme des panneaux solaires, qui transforment le gaz carbonique en carbone organique (sous forme de sucres plus ou moins complexes), qui va se déposer sous forme liquide au niveau des racines (les exsudats), pour former un humus très stable.
Pour résumer, la matière organique des sols (humus), de par sa composition, son organisation moléculaire et grâce au travail des êtres vivants, va apporter de la stabilité à la structure du sol, augmentant ainsi le taux d’oxygène dans les espaces lacunaires (indispensable à la croissance des racines) et améliorant l’infiltration de l’eau et son stockage.
Les bénéfices de la gestion des déchets verts … pour la biodiversité au jardin
Plus un système est riche et complexe, plus il est stable, et plus grande est sa capacité à résister aux perturbations extérieures et à retrouver structures & fonctions de son état de référence. Au jardin, nous allons chercher cette complexité, par la multiplicité des formes de vie (espèces animales et végétales déjà présentes), par la multitude des interactions entre elles et par la richesse de ces lieux en abris, caches, gîtes et repères.
La recette ?
Accueillir, nourrir, héberger les êtres vivants, sans distinction aucune : de l’orvet aux chauves-souris, des abeilles solitaires aux punaises prédatrices, des forficules au crapaud commun en passant par les guêpes parasitoïdes. En cela, la matière organique que nous avons à disposition – lesdits déchets verts – va être bien utile. Tas de branches, fagots de tiges creuses, mais aussi allées de broyat, herbes sèches ou feuilles laissées sous la haie : voici de quoi ravir pléthores d’êtres vivants qui feront de cette matière un lieu d’hivernage ou d’estivation, de demeure ou de garde-manger.
Les ingrédients ?
- Installer une haie sèche au jardin, et faire d’une pierre deux coups : créer un havre de biodiversité tout en réduisant ses aller-retour à la déchetterie.
- Pailler son sol pour limiter les arrosages, le désherbage… et accueillir de multiples formes de vie dans son jardin


Découvrir nos formations
-
Gérer les déchets végétaux sur les chantiers
Méthode et outils à destination des jardinier·es-paysagistes
-
Gérer les déchets végétaux en collectivité – II
Partie II : Spécialisation technique et PERSPECTIVES Présentation Cette formation fait suite à la première journée de formation « Gérer les déchets végétaux en collectivité – I ». Il s’agit d’une formation de spécialisation avec une mise en perspective au sein de la collectivité. Un focus technique est apporté sur le choix des végétaux, l’entretien…
-
Créer et animer un jardin pédagogique
S’outiller à la conduite d’un jardin pédagogique de sa conception à son accompagnement
-
Gérer les déchets végétaux en collectivité – I
Partie I : Broyage, paillage et compostage Présentation Cette formation est une introduction aux différentes formes de valorisation in situ des déchets végétaux (mulching, broyage, paillage, compostage, etc.). Elle permet d’acquérir une connaissance des enjeux et outils de la prévention et gestion de proximité des déchets végétaux, afin de mettre en pratique des alternatives d’entretien…
-
Réaliser son terreau sans tourbe
Pour ses plantations et productions de plants.
-
Déchets végétaux, accompagner son territoire
Vers une gestion zéro déchetterie !

